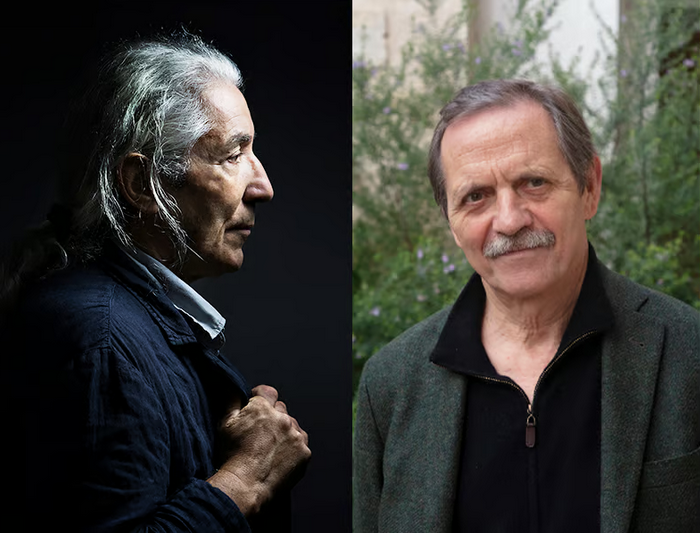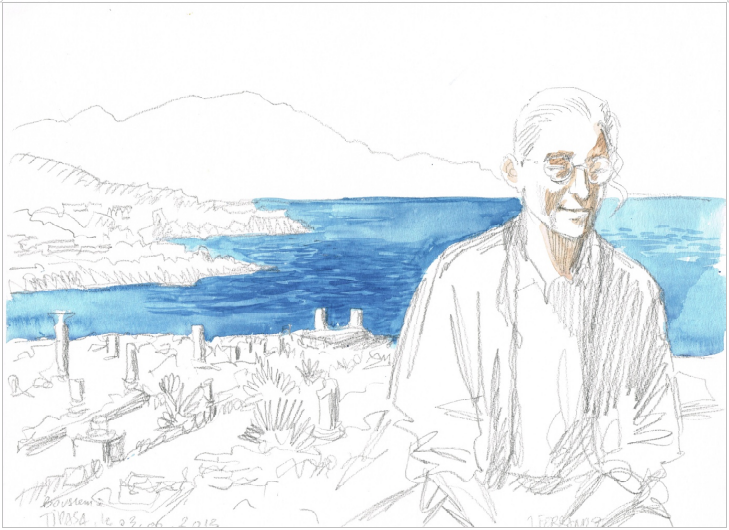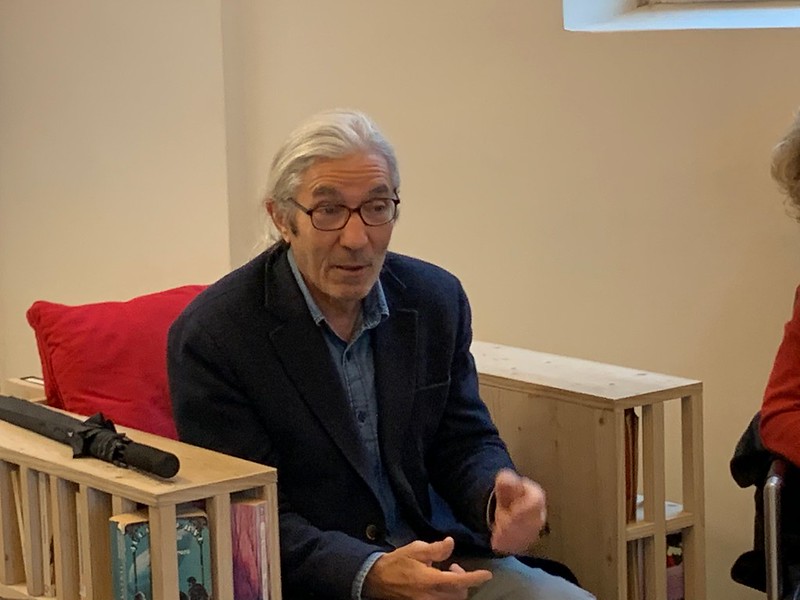Lisa Romain, enseignante et auteur d’une thèse sur l’œuvre de Boualem Sansal, est membre du comité de rédaction du site Littérature et liberté.
[Une première version de cet article est parue le 24 décembre 2024 dans La Revue politique et parlementaire.]
Il faudra bien, à un moment donné, que ceux qui jugent Boualem Sansal sans l’avoir lu finissent par le faire. En attendant, puisqu’il y a urgence, et même si cela contredit l’éthique de lecture personnelle et active que promeut l’ensemble de l’œuvre sansalienne, voici un aperçu de ce que nous disent ses livres.
Boualem Sansal est entré en littérature à la fin des années 90. Parti d’une « contemplation hallucinée »1 de la décennie noire algérienne, il en a progressivement repoussé les frontières temporelles et géographiques pour aboutir à une « Constitution universelle » à l’usage de la « République des hommes libres »2. Ce cheminement lui a permis de proclamer de plus en plus fort qu’il « n’y a pas de honte à préférer le bonheur »3, qu’il n’est ni simplet ni aberrant d’aspirer à « l’amitié » des « peuples et nations de la terre »4.
Comment cependant atteindre cet horizon aveuglant de clarté mais qui, sans cesse, se dérobe ? La réponse s’est elle aussi affirmée au fil de l’œuvre. Elle est à l’image de la question posée, terriblement simple et complexe à la fois : l’union fait la force.
Ainsi Le Serment des barbares, premier roman de Boualem Sansal, traversée infernale hantée par le chagrin et l’indignation, allume-t-il dans ses dernières lignes la flamme d’un espoir : le lecteur pourrait s’impliquer, il pourrait être le continuateur de l’œuvre, de la même manière que par la suite l’Écrivain prolongera l’œuvre de Tarik5, que Malrich prolongera le journal de Rachel6, que Nele prolongera le roman de Léa qui elle-même prend la suite de sa mère Élisabeth7.
Pour mener à bien leur quête commune, l’auteur passerait avec son lecteur par tous les cercles de l’enfer, gravissant avec lui « l[es] colline[s] oubliée[s] », traversant les geôles et les souterrains8, les antichambres d’administrations absurdes aux terribles gardiens9, les déserts reculés10 « parsemés de montagnes et de ravins »11, « les enfilades de salles plus ou moins vastes [aux] portes fermées à clé, dont la clé ser[ait] dissimulée quelque part dans le fouillis »12, parcourant en sa compagnie le temps et l’espace, du commencement à la fin du monde. Pourrait alors advenir le « livre qui reste à écrire »13. Cet ouvrage collectif à la forme inédite, que le lecteur est appelé à « compléter » « en puisant dans son propre espace »14, permettrait de sortir du « temps circulaire »15 des guerres et des divisions auxquelles semble s’être condamnée l’humanité, et de délier leurs boucles mortifères en grandes chaînes de solidarité.
Or, la virtualité de ce partenariat avec le lecteur, née dans la fiction, s’est progressivement incarnée au point d’en sortir, et je laisse ici la parole à Boualem Sansal lui-même : « Je ne développerai pas le calcul qui m’a permis d’identifier ces catégories, le lecteur le trouvera bientôt sur le site que j’ai l’intention de créer dans le but d’y loger ma feuille de calcul ainsi que les références bibliographiques qui m’ont permis de documenter ma lettre. Il sera invité à faire des commentaires auxquels je ne manquerai pas de répondre. Je rappelle, si vous l’avez oublié, que le but de ma lettre est qu’elle soit le préambule de la constitution d’un monde nouveau, à inventer, où vous, nous, peuples et nations de la terre, serons rois éternels en nos demeures. Vos avis ont force de loi dans la recherche conjointe de la vérité. »16
D’un bout à l’autre de son itinéraire, Boualem Sansal, profondément humaniste par la conjonction équilibrée de son savoir littéraire, scientifique et philosophique, s’est ainsi employé à explorer sous tous les angles l’hypothèse d’une « Alliance »17 avec ses lecteurs. Mieux : il l’a soumise par la fiction à tout ce qui était susceptible de l’invalider. Dans cette mesure, ses romans apparaissent comme la modélisation des obstacles à une paix qui n’est pourtant peut-être pas si « impossible »18.
Il y a d’abord tout ce qui compromet l’engagement dans son expression, alors même qu’il est porté par des gens pétris de qualités morales et intellectuelles. Deux dérives polarisées à l’extrême sont examinées. D’un côté, une galerie de héros tentés par la faiblesse et la passivité : par timidité et par gentillesse (Larbi avant sa révolte), par chagrin tourné à l’aigreur misanthrope et résignation fataliste (Lamia, Yazid), par tendance à l’apitoiement complaisant (Rachel, Yazid), par le recours à des grilles de lectures qui enferment et paralysent le jugement (Rachel, Élisabeth). De l’autre côté, il y a les forts et les actifs, que d’autres écueils menacent : grisé par ses succès et sa force de persuasion, un leader vertueux peut devenir mégalomane, ou déraper (Pierre, Tarik). Certains meneurs peuvent succomber à une témérité dangereuse, sous l’effet de pulsions suicidaires désespérées (Larbi), ou désinhibés par une inculture qui a l’inconvénient de les exposer aux simplifications les plus fâcheuses (Malrich, Ati). Et puis, il peut arriver qu’on s’engage d’autant plus passionnément qu’on a des tendances délirantes (Élisabeth/Ute, Brahim/Abraham). Contournant tous ces pièges Paolo, le narrateur de Vivre : le compte à rebours part immédiatement à la recherche des autres « Appelés »19. Métaphorisant le partenariat auquel aspire Boualem Sansal de part et d’autre de la fiction, sa voix se fond finalement dans celle de l’auteur lorsqu’elle nomme le récit qui vient de s’achever. Un autre monde peut s’ouvrir dans l’épilogue.
Ces projections ne sont pas seulement thématiques – et le génie de l’écrivain s’exerce sans doute surtout en cela. C’est le langage lui-même qui menace les voix qui s’engagent. Le langage et ses connotations, ses collocations imposées, ses énoncés en mention qui tirent sur la laisse et emmènent celui qui l’emploie là où il ne voulait pas forcément aller, le faisant dévier malgré lui. Mais qu’on essaye de le figer, de le juguler, et il se transforme en une matière morte qui, incapable de s’adapter, ne dit plus rien du tout. Et cela s’aggrave encore quand il y a interlocution. Les romans de Boualem Sansal sont aussi le théâtre de situations où une parole engagée qui savait parfaitement où elle souhaitait se rendre s’égare en chemin par politesse, par compassion, par manque d’assurance où alors au contraire par excès de confiance, par orgueil et plaisir de celui qui la porte de s’écouter discourir brillamment.
C’est pourquoi le langage chez Boualem Sansal n’est ni débridé ni dompté, mais résistant. Il lui faut des garde-fous, dressés par celui qui l’émet mais également par celui qui le reçoit. L’œuvre sansalienne reformule en ce sens la prière d’Ulysse : quand la parole engagée cède aux chants des sirènes de la soumission, de la flatterie, de l’orgueil, de la tentation du coup d’éclat, ne la laissez pas faire, aidez-la à se contenir et à se reprendre. Dans cette odyssée vers la paix, il est donc vital d’avoir des compagnons sur lesquels on puisse compter – des lecteurs capables de lire avec rigueur et sensibilité20, prêts à remettre en question ce qu’ils lisent et à rester méfiants quand bien même ils sont spontanément acquis à l’auteur.
Cela encore, l’auteur le modélise. Non seulement son œuvre foisonne de figures de mauvais interprètes, mais en plus, elle ne cesse de tendre des pièges à ceux qui voudraient lire trop vite, avec des attentes déplacées (se documenter sans tenir compte de la source et du contexte, ou vouloir conforter coûte que coûte une opinion déjà forgée). Les comptes rendus erronés, les contradictions, les gags qui se glissent au cœur des raisonnements les plus érudits, les dérapages narratifs, les décalages énonciatifs, ne doivent pas être acceptés sans ciller.
Ces contrôles de lecture sont ludiques si l’on veut, et sont une déclaration d’amour à l’heuristique alchimique : « La construction du roman [sansalien] s’éloigne notablement des cadres habituels de la narration romanesque et peut dérouter, mais ainsi est le chemin de la vérité, bien fait pour nous perdre. Dans cette vie, rien ne nous est donné gratuitement. La lecture, si elle s’accompagne d’une véritable méditation, est un acte initiatique. »21 Il s’agit toutefois aussi d’un raisonnement éminemment politique. Le lecteur est un citoyen. À ce titre, il est prié de lire, et de faire attention à ce qu’il lit, même quand cela lui paraît rebutant. La démocratie vaut bien cet effort. Une symbiose originale de l’engagement et de la littérature s’opère alors : les deux lignes, la fictionnelle et la non-fictionnelle, finissent par converger, et rien ne l’illustre mieux que ce fameux site internet, utopie participative que les événements n’ont pas encore permis à Boualem Sansal de bâtir. C’est bien pour cela que son œuvre est un lieu dédié à l’intelligence, inter ligare : créer des liens, lire, relire, relier, s’allier.
Que ceux qui s’accommodent de l’emprisonnement de Boualem Sansal sachent que c’est cette proposition plus que décente qu’ils sont en train de rejeter « sans se brûler le cœur »22. Qu’ils sachent qu’ils sont en train de repousser une tentative inédite d’aménager un espace de dialogue et de débat et que, décidément, ce refus ne fait pas honneur à l’intelligence.