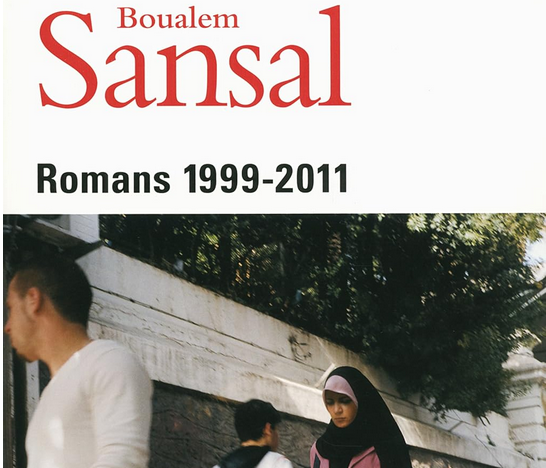Jean-Marie Laclavetine, romancier et éditeur de Boualem Sansal, nous autorise à reproduire la préface qu’il a écrite pour l’anthologie de Boualem Sansal : Romans (1999-2011), Gallimard, « Quarto », 2015.
Nous publions ici la troisième et dernière partie de cette préface, où il est question de Rue Darwin, roman reflétant « la formation de l’écrivain » Boualem Sansal.
[1ère partie] [2e partie]
Si Le village de l’Allemand est le roman qui rassemble d’une façon à la fois claire et bouleversante les thèmes fondamentaux de l’œuvre, Rue Darwin en donne des clés plus intimes. Dans le premier, Sansal fait courir ses fils narratifs dans l’histoire récente, de la montée du nazisme à aujourd’hui, à travers l’Europe et le Maghreb en plein désarroi, entraînant le lecteur dans un récit qui culmine avec la visite d’un jeune Algérien à Auschwitz. Tout y est dit des difficultés et des impasses où se trouve l’Occident au début du 21ème siècle, et il n’est pas surprenant que ce roman ait connu un écho international aussi fort. Dans le second, le romancier révèle l’incroyable histoire de son enfance. Yazid, le narrateur, est né comme l’auteur en 1949 au fin fond de l’Atlas – les éléments autobiographiques sont ici innombrables, mais la littérature est un miroir aux effets parfois volontairement trompeurs. La flamboyante Djéda, grand-mère de Yazid, héritière de la tribu des Kadri, a fait fortune dans le commerce à partir de son fief villageois ― fortune dont le point de départ fut le florissant bordel jouxtant la maison familiale. Elle a des propriétés partout en Algérie et en France (même à Vichy, où elle a logé le Maréchal dans une de ses maisons pendant la guerre). Elle est en cheville avec les militaires français aussi bien qu’avec les chaouchs algériens. Yazid est le fils de Farroudja, une des prostituées du grand lupanar aux allures de phalanstère possédé par Lalla Sadia. Celle-ci a un fils, Kader, marié mais stérile. Lorsque Kader meurt dans un accident de voiture, la grand-mère confisque Yazid à la jeune Farroudja pour l’offrir à la veuve de son fils. Farroudja est expédiée à Alger, et Yazid grandira loin d’elle au village, dans l’ignorance de son origine. La veuve de Kader, ne supportant pas l’emprise de sa belle-mère, abandonnera à son tour le village où elle laisse Yazid. Il y grandira comme une herbe folle. Farroudja, sept ans plus tard, va organiser avec succès l’enlèvement de son fils. Il vient vivre avec elle à Alger, rue Darwin, à deux pas du domicile qui fut celui d’Albert Camus et de sa mère, dans un quartier où « cinquante nationalités vivent les unes sur les autres ». Après l’enfance radieuse et choyée dans la bourgade rurale où tout ou presque appartenait à Djéda, loin du phalanstère grouillant et chaleureux commence une nouvelle vie. Comme tant d’autres gosses, Yazid participera à la bataille d’Alger en portant des messages et en accomplissant de petites missions. Boualem Sansal évoque avec bonheur cette période où, comme son personnage, il s’est senti libre soudain, « indépendant avant l’indépendance ». La ville en bataille est un terrain de jeux. Mais la guerre commence à diviser les populations qui jusque-là vivaient en bonne entente, y compris les enfants. Manifestations énormes, quotidiennes, attentats, combats de rue… L’enfance s’achève dans le fracas des armes.
Rue Darwin offre d’innombrables croisements entre la réalité biographique et l’invention romanesque. C’est le roman où se raconte la formation de l’écrivain. La formidable figure de Djéda domine le récit, très proche de ce qu’elle fut dans la vie. Lalla Sadia, une des plus grandes fortunes d’Algérie, n’a pas été inquiétée par le FLN après l’indépendance, malgré ses accointances avec le colonisateur. Il faut dire qu’elle y a mis du sien : lorsque Ben Bella lance une collecte d’or pour assurer la création du dinar, tandis que la population pleine de ferveur apporte les bijoux de famille, Djéda fait don de cinq quintaux d’or au nouvel état, qu’elle remet en mains propres et en grande pompe au Président. Moyennant quoi elle finira tranquillement ses jours dans son palais d’Hydra, ancienne demeure de la jeune et ravissante Ranavalona III, reine de Madagascar jadis exilée par Galliéni. Ce palais sera bientôt récupéré par un notable du FLN, prénommé Abdelaziz… Ainsi, comme dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change.
L’autre femme essentielle, dans le roman comme dans la vie, c’est bien sûr la mère. Elle fait l’objet d’une authentique vénération de la part de l’écrivain. Elle était dans la réalité la fille d’un militaire d’Oran, rigoriste, pro-français, champion de gymnastique. À dix-sept ans elle tombe amoureuse d’un jeune oisif fortuné, pianiste à ses heures, fils de la fameuse Djéda décrite dans Rue Darwin. Il a trente ans, et cet amour déplaît dans les deux familles : la jeune fille vit en ville, elle est « française » (c’est-à-dire « infidèle »), cultivée, ce qui n’inspire guère confiance chez une femme ; quant à lui, il incarne pour sa future belle-famille l’Algérie rétrograde et paresseuse des clichés coloniaux. L’union se fera malgré tout, contre l’avis des familles. La jeune fille part au lointain village, et le drame se produit : son mari meurt accidentellement peu après la naissance de Boualem. Djéda s’empare de l’enfant, chasse la mère qui débarque à Alger et se retrouve rue Darwin dans une chambrette prêtée par le rabbin local. Elle trouve un emploi de femme de ménage à l’hôpital Mustapha, rencontre un homme très doux père de plusieurs enfants. Elle en aura d’autres avec lui. C’est ainsi que Boualem, lorsqu’elle mourra, battra le rappel de ses frères et sœurs à peine connus dispersés à travers le monde, comme Yazid au début de Rue Darwin.
Le motif de la double maternité revient souvent dans l’œuvre de Sansal. Ainsi, dans L’enfant fou de l’arbre creux, Pierre apprend qu’il n’est pas le fils de sa mère, mais d’une autre femme, Aïcha. Comment ne pas voir là, au-delà de la biographie de l’auteur lui-même, l’image d’une inguérissable douleur identitaire, d’un déchirement commun à tous les Algériens, qui ont en quelque sorte deux mères ? Cette double filiation mystérieuse, secrète, honteuse parfois, faute de pouvoir être vécue sereinement, rend l’estime de soi problématique. Parlant des deux pays, Yazid dit que « tous deux ont failli à l’honneur de la guerre et de la paix, la honte est une gangrène, elle ne guérit pas, elle se propage, il faut couper toujours plus haut et un jour nous serons forcés de trancher à la gorge pour nous guérir du péché originel. » D’un côté comme de l’autre de la Méditerranée, l’abandon de la jeunesse aux discours des extrémistes musulmans a des conséquences visibles à l’œil nu. Dans Le Village de l’Allemand, Malrich parle ainsi de la banlieue française où il habite : « Peu à peu nous oublions que nous vivons en France, à une demi heure de Paris, et nous découvrons que les valeurs qu’elle proclame à la face du monde n’ont en réalité cours que dans le discours officiel. (…) Tout ce que nous nous interdisons en tant qu’hommes et citoyens français, les islamistes se le permettent (…) À ce train, parce que nos parents sont trop pieux et nos gamins trop naïfs, la cité sera bientôt une république islamique parfaitement constituée. Vous devrez alors lui faire la guerre si vous voulez seulement la contenir dans ses frontières actuelles. »
« Ma formation », dit-il, « et le contexte historique ont donné à mon travail cette forme particulière. Durant toutes ces années de jeunesse, lorsque nous discutions entre étudiants, avec les pieds rouges ou avec mon ami Rachid Mimouni, nous ne parlions que de l’Algérie, du choix d’un modèle… Mais tous les choix ont été faits par le pouvoir, et nous voilà étrangers dans notre propre pays ».
Boualem Sansal ne dit pas ces mots au hasard. Un épisode de sa vie est particulièrement révélateur de ce sentiment d’étrangeté, et de ses conséquences. Dans sa jeunesse, l’écrivain a rencontré une jeune Tchèque au cours d’un de ces voyages d’été que les républiques socialistes organisaient volontiers. Ils se sont mariés, et elle est venue vivre avec lui en Algérie après avoir surmonté toutes sortes de difficultés administratives. Ils ont eu deux filles, Nanny et Sabine. Un jour, allant chercher Nanny à l’école, Boualem ne la trouve pas à la sortie. Affolé, il interroge d’autres élèves, cherche partout, court le quartier en vain. Puis il revient vers l’école et tombe sur une file d’enfants qui arrive, menée par un homme barbu en tenue traditionnelle. Nanny est parmi eux. Il questionne l’accompagnateur, et apprend que ces enfants reviennent de la mosquée. La directrice de l’école, sommée de s’expliquer, répond sèchement qu’un programme religieux a été mis en place pour les enfants de couples mixtes. Les parents n’en ont pas été prévenus. C’en est trop : ils retirent Nanny de l’école, on l’envoie à Prague, où sa sœur et sa mère la rejoindront. Commence pour Boualem une période d’allers et retours incessants en Tchécoslovaquie. La famille n’y survivra pas, brisée comme tant d’autres par l’ordre étriqué mis en place par un pouvoir peu à peu gagné par le fondamentalisme islamique. De nombreux couples mixtes ont ainsi vu leurs vies brisées. Les femmes étrangères étaient considérées comme un danger pour la société musulmane. Soit elles acceptaient de se convertir et de se voiler, soit elles étaient réprimées, expulsées. Celles qui travaillaient étaient victimes de fatwas, assassinées parfois. La plupart ont fini par quitter le pays. C’est la source d’innombrables drames familiaux, d’autant que les enfants n’étaient pas toujours autorisés à suivre leur mère. On a assisté au fil des ans à une hémorragie des intellectuels et des gens cultivés, qui préféraient l’exil à l’étouffoir.
Dès lors il ne reste que l’écriture. Dès son premier roman Boualem Sansal a imposé la puissance d’une littérature écrite « à la lumière des Lumières », portée par le miracle d’une langue réinventée. « En Algérie, nous sommes analphabètes trilingues : nous avons perdu le français à cause de l’arabisation forcée, l’arabe est peu ou mal enseigné, nous avons perdu le kabyle et nos langues ancestrales. » Le seul langage qui reste à la plupart, c’est la violence. Le romancier, lui, dispose de la langue, cette langue exaltée, magnifiée par la solitude rougeoyante de la forge où se forment les phrases, cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge selon Baudelaire. En lui se côtoient la colère et la fraternité. De sa voix puissante et généreuse, l’écrivain libéré de toute contrainte, marqué par des pertes douloureuses, fait de livre en livre l’inventaire de l’Algérie postcoloniale avec sa verve inimitable, sa truculence joyeuse, ses énumérations drolatiques, ses dialogues emportés d’ivrognes pas si fous qu’ils n’en ont l’air (Dis-moi le Paradis), ses morceaux de bravoure hilarants et caustiques, sa fureur joyeuse, ses plaintes déchirantes (Lamia, dans Harraga, se désolant de voir tous ces jeunes gens brûler la route, brûler leurs vies : « A-t-on idée d’aller mourir loin de sa tombe ? »…), ses hymnes à la gloire de la splendide Alger, ses recherches scrupuleuses sur l’islam, sur l’histoire du FLN et de ses ramifications, tout cela formant un chant de tristesse et d’amour sans équivalent dans la littérature francophone d’Afrique du Nord. Il y élabore des fresques baroques qui nous entraînent dans les parages de Carlo Emilio Gadda, de José Lezama Lima, de Céline ou de Rabelais, faisant à notre langue le cadeau d’une jeunesse neuve. Le voilà : enflammé, drôle, féroce, courageux, tel que nous avons appris à le connaître. Rien d’étonnant à ce que ses livres soient lus comme ils ont été écrits : avec passion.